

Montesson, petit village maraîcher était encore il y a vingt ans une toile d’araignée tissée par de la voie de 40 installée là, à des fins agricoles.
Aujourd’hui, après le passage à la " mécanisation moderne " : tracteurs ; canons à eau, cette toile s’est réduite à quelques fils.
En se promenant dans la plaine, coupée en deux par l’autoroute A14 (l’autoroute la plus chère du monde), mais, préservée - pour combien de temps encore de toute construction - on rencontre ça et là quelques tas de rails, des wagonnets isolés et des mouilleurs (arroseurs) dont certains sont encore en activité.
Quelques voies sont en place, préservées ou posées à dessein par certains " anciens " irréductibles et peut-être nostalgiques.

Amoureux de ces petits trains et motivé par la préservation du patrimoine ferroviaire français, j’ai entamé il y a cinq ans environ une récupération patiente, ce qui m’a permis de sauver des mâchoires de la presse une douzaine de wagonnets, 500 m de rail et diverses pièces comme des aiguillages, plaques tournantes, dérailleurs, etc.
Avec le fruit de cette récupération, j’ai implanté au fond de mon jardin un petit réseau sous l’oeil curieux des voisins et badauds.
Ceci fera l’objet
d’un prochain article pour ![]() .
.
Afin de mieux connaître ce chemin de fer, je pris rendez-vous avec Monsieur Jean Laglantine, maraîcher à Montesson depuis 50 ans qui me raconta ce qui va suivre.
Naissance du chemin de fer
Avant la derrière
guerre, la plaine de Montesson était " travaillée à la main ", la
terre était retournée à la bêche, le transport des outils, des semences et des
récoltes se faisait à dos d’homme à l’aide de hotte. Ceci avait pour effet de
provoquer le tassement de la terre à cause du piétinement continuel, qui rendait le
travail encore plus difficile et nuisait aux récoltes.
Dans le même temps, les carrières de Croissy et de Carrières-sur-Seine voyaient leurs gisements
arriver à expiration. À noter
qu’une grande partie des monuments de Paris furent construits à l’aide des
pierres extraites de ces carrières qui disparurent pour laisser place aux
champignonnières qui prirent la relève.
Les carriers utilisaient très tôt les wagonnets et la voie portative de 40. Les
maraîchers comprirent rapidement l’intérêt d’un tel matériel et son
transfert s’effectua tout naturellement du sous sol vers la plaine.
On vit alors apparaître des wagonnets, plats, à plate-forme élargie pour remplacer les
hottes, des wagonnets à benne ou berce pour le transport et l’épandage du fumier et
enfin les fameux mouilleurs pour l’arrosage des cultures.
Le tissage de la toile était amorcé et peu à peu, ce que Paul Decauville avait décrit,
vit le jour à Montesson.
Le matériel de voie.
Il était
essentiellement constitué par de la voie portative en rail de 4,5 kg/m, riveté sur
traverses métalliques formant des coupons de 5 m de marque Decauville Acier ou Schneider
au Creusot.
Quelques essais eurent lieu en voie constituée de rails de 7 kg/m ou en voie de 50 en
rails de 7 et 9 kg/m, mais ce matériel fut vite abandonné à cause de son poids
dissuasif pour déplacer la voie.

Le matériel roulant
Il n’y eut jamais de matériel de traction mécanique. Seule la traction hippomobile fut testée, mais vite abandonnée à cause du poids des chevaux qui tassaient la terre. D’autre part le recours aux chevaux ne pouvait se justifier que par la traction de train de wagonnets, ce qui était chose rare. En fait un homme poussait un wagonnet.
Les wagonnets utilisés étaient de marque



![]() d’où
d’où ![]()
où
r = longueur d’un bras
![]() = angle du bras par rapport à la voie
= angle du bras par rapport à la voie
l= largeur à arroser
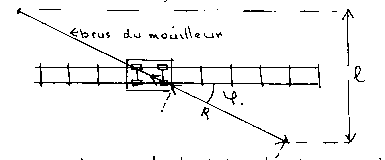
Deux types de mouilleurs furent utilisés.
Le type Graff du nom
du constructeur.
Ce modèle donna les meilleurs résultats en assurant un arrosage performant, une
brumisation par enchevêtrement des cônes d’eau issue des buses.
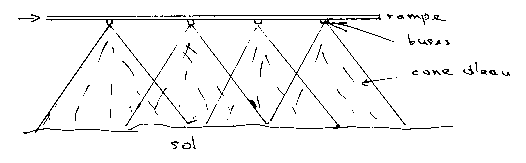
Le type Tours, appelé ainsi car il était construit à Tours. Ce modèle était moins performant, car l’eau issue des buses était moins atomisée. Elle arrivait même à tasser la terre. Malgré des essais d’amélioration, ce modèle ne donna jamais réellement satisfaction.
Avantages de ces appareils
" Globalement toute l’eau utilisée était distribuée au bon endroit (contrairement aux canons à eau d’aujourd’hui qui sont utilisés pour un arrosage plus industriel). Grâce aux vannes disposées sur les bras et à l’angle réglable des bras, il était possible d’arroser uniquement là, où c’était nécessaire.
Défauts de ces appareils
Pourtant, dans l’ensemble, les mouilleurs assurèrent de bons et loyaux services et ce, pendant de nombreuses années, sans compter sur le joli spectacle qu’ils offraient dans la plaine. Les nuits de pleine lune, Montesson n’avait rien à envier à Versailles à l’exception du château.
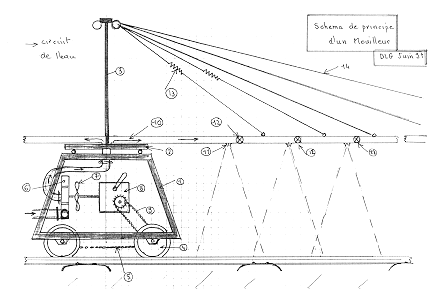
| Numéro | Dénomination | Commentaires |
| 1 | châssis | cornières métalliques de 50 mm |
| 2 | tourelle rotative | montée sur galets ou platine fonte pour orientation des bras |
| 3 | mât | point d’ancrage des haubans |
| 4 | roue en fonte f =250 mm | |
| 5 | chaîne d’accouplement | arbre de 25 mm acier au silicium |
| 6 | turbine à eau | munie de 5 aubes en laiton, c’est le moteur de l’engin |
| 7 | volant de démarrage | destiné à lancer l’engin |
| 8 | boîte de vitesse | 2
rapports plus 1 point mort, mais pas de marche arrière visse sans fin plus une couronne |
| 9 | chaîne de traction | |
| 10 | tuyaux servant de bras d’arrosage | longueur de 12 m de chaque coté de l’axe du mouilleur |
| 11 | buse d’arrosage | |
| 12 | vanne de barrage pour l’eau | destinée à couvrir les surfaces à arroser |
| 13 | tendeurs de haubans | |
| 14 | haubans | câble en acier |
En écrivant cet article, j’ai été amené plusieurs fois à appuyer sur le frein de mon stylo, car je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup à raconter. Peut-être même qu’avec de l’abnégation et un patient travail de recherche, il y aurait matière à écrire un livre. Enfin au travers des témoignages recueillis, j’ai compris que c’était avant tout une histoire d’hommes avec leurs travers et leurs qualités et malgré, les envies, les jalousies, les exactions, la solidarité avait le fin mot.
En somme, un monde de fourmis laborieuses, juchées sur une toile d’araignée métallique.
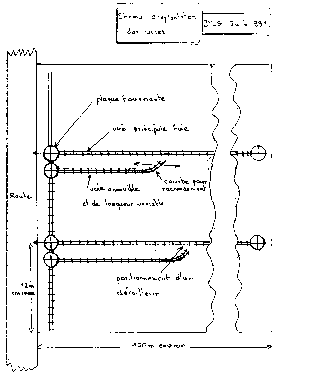
Schéma d’implantation des
voies