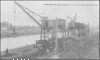Le carnet
du CFC
Quelques photos de
l'usine à gaz de Villeneuve-la-Garenne
MAD
 J'ai
retrouvé aux archives municipales de Gennevilliers ce plan ancien de
l'usine à gaz de Villeneuve-la-Garenne avec son réseau interne de voies
normales embranchées sur la ligne Paris-Nord—Pontoise en aval de la gare de
Gennevilliers.
J'ai
retrouvé aux archives municipales de Gennevilliers ce plan ancien de
l'usine à gaz de Villeneuve-la-Garenne avec son réseau interne de voies
normales embranchées sur la ligne Paris-Nord—Pontoise en aval de la gare de
Gennevilliers.
Je ne connais pas la date de ce plan, mais on voit les trois voies qui étaient
situées sur la longue estacade en bord de Seine sur laquelle des trains de
charbon étaient chargés à partir des péniches pour être acheminés vers la
cokerie. Semble-t-il ces trains étaient ramenés à la gare marchandises de
Gennevilliers avant de reprendre le chemin de l'usine.
En revanche on distingue très nettement l'amorce de l'ancienne voie ferrée qui longe la
Seine et que nous avons bien connue en activité au début du CFC et qui
desservait les chantiers navals et le stockage de bière.
Les travaux de fondations des cokeries de la Seine commencent en 1927 et
l'usine ouvre ses portes en 1929, année où Villeneuve-la-Garenne devient une commune
indépendante de Gennevilliers. Son activité consiste à distiller les charbons français du Nord-Pas-de-Calais, anglais
et allemands, qui arrivent par chemin de fer et par voie navigable. Située sur le boulevard Dequevauvilliers, elle constitue une des plus importantes industries de la commune. Elle alimente l’usine à gaz toute proche, qui se trouve en partie sur Villeneuve.
Bombardée le 2 août 1944, elle subit beaucoup de dégâts.
L'usine produit du gaz manufacturé, ou gaz de ville, généralement à partir de
charbon et plus particulièrement de houille. Cette industrie du gaz a connu une forte expansion en Europe aux
XIXe et XXe siècles. L'usine de Villeneuve-la-Garenne de taille importante
fait son apparition dans le paysage initialement maraîcher et agricole qui se transforme en
paysage industriel marquant l'imaginaire collectif des habitants.
Petit à petit l'utilisation du gaz naturel au pouvoir calorifique bien
supérieur supplante les énormes usines polluantes et les gazomètres
disparaissent les uns après les autres laissant place à des friches
industrielles.
Si en Grande Bretagne certains gazomètres ont été classés, en est-il de
même en France ?
Historiquement le gaz de bois (gaz d'éclairage) est vite abandonné au profit du gaz de
houille fabriqué à partir d'un fourneau, dans lequel on introduit verticalement,
par gravité, une cornue qui se
pose sur un trépied de fer battu et qui envoie le gaz dans un condensateur divisé en trois compartiments superposés :
- l'un supérieur contenant de l'eau
- l'autre au milieu contenant une solution de potasse caustique, composée d'environ deux parties de potasse et de seize parties d'eau, ou d'un mélange de chaux vive et d'eau, à la consistance d'une crème très-légère
- le troisième, au-dessous, restant vide pour recevoir le goudron que l'on soutirait au moyen d'un robinet, pour que le gaz se rendît ensuite dans le gazomètre, où il n'arrivait qu'après avoir traversé une multitude de petits trous formés à un coude recourbé dans l'eau de la cuve et
où, plus sa surface était divisée, mieux le gaz se lavait et se
purifiait.

 La
Seine. C'est par la Seine qu'arrivait le charbon destiné à l'usine à gaz.
Chargé sur des péniches, celles-ci étaient déchargées à l'aide d'une batterie
de grues dans des wagons tombereaux internes à l'usine.
La
Seine. C'est par la Seine qu'arrivait le charbon destiné à l'usine à gaz.
Chargé sur des péniches, celles-ci étaient déchargées à l'aide d'une batterie
de grues dans des wagons tombereaux internes à l'usine.
Sur cette carte postale, on reconnaît bien l'estacade en ciment armé
supportant une batterie de grues à godet.


 L'estacade
bien connue des membres du CFC dont certains se sont, il y a bien longtemps
risqués dans ses entrailles. Construites en béton armé elle accueillait trois
voies.
L'estacade
bien connue des membres du CFC dont certains se sont, il y a bien longtemps
risqués dans ses entrailles. Construites en béton armé elle accueillait trois
voies.
Il est encore possible de voir aujourd'hui les agrafes de fixation des rails.
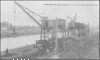 Les
grues enjambaient la rame de wagons tombereau vides et étaient placées sur la
voie la plus proche de la rive. Des petites 020-T assuraient le service interne
à l'usine.
Les
grues enjambaient la rame de wagons tombereau vides et étaient placées sur la
voie la plus proche de la rive. Des petites 020-T assuraient le service interne
à l'usine.
 La
cokerie, constituée d'une batterie de fours
La
cokerie, constituée d'une batterie de fours
Au premier plan les portiques de déchargement, un autre élément bien connu
des plus anciens.
Chimiquement la fabrication du gaz est une fabrication discontinue, il faut
charger la houille par gravité et décharger le coke incandescent des cornues, sous-produit disponible à
la revente. Toutes ces opérations se faisant à chaud (il faut élever la
température à 1100° pour transformer le charbon en coke) et les ouvriers
étaient exposés à la chaleur, à la poussières et aux vapeurs toxiques lors
de l'aspersion d'eau pour le refroidissement du coke.
Dans un premier temps les usines à gaz (ou usines à cornues) étaient construites pour produire le gaz de
houille.
Le coke, obtenu par pyrolyse de la houille dans un four à l'abri de l'air,
devient un sous-produit de la fabrication du gaz, revendu et suffisant à payer la
matière première. Dans un second temps, l'approvisionnement en gaz se fit auprès des cokeries. Le gaz était devenu un sous-produit de la fabrication du coke. Ce développement des cokeries fut favorisé par l'essor de la carbochimie à partir de 1920 et
de nouveaux sous-produits du coke
issus des matières volatiles sont valorisés lors de la contraction de la pâte de coke: benzol, hydrogène,
éthylène, acétylène, etc.

 Les
fours regroupés en batterie, dans lesquels le charbon est enfourné pour
être élevé à une température de 1100° pendant une durée qui varie de 16
à 40 heures. Les fours sont chauffés par des carneaux
latéraux (la sole et la voûte n'étant pas chauffées) dont la température
peut atteindre 1300°.
Les
fours regroupés en batterie, dans lesquels le charbon est enfourné pour
être élevé à une température de 1100° pendant une durée qui varie de 16
à 40 heures. Les fours sont chauffés par des carneaux
latéraux (la sole et la voûte n'étant pas chauffées) dont la température
peut atteindre 1300°.

 Les
gazomètres à colonnes sont une sorte de réservoirs servant à stocker le gaz de ville à température ambiante et à une pression proche de la pression atmosphérique. Le volume du réservoir varie selon la quantité de gaz qu'il contient, la pression étant assurée par une cloche mobile verticalement.
Sur la photo de gauche, la cloche est à son niveau maximum, alors que celle de
droite le volume de gaz stocké est bien moindre.
Les
gazomètres à colonnes sont une sorte de réservoirs servant à stocker le gaz de ville à température ambiante et à une pression proche de la pression atmosphérique. Le volume du réservoir varie selon la quantité de gaz qu'il contient, la pression étant assurée par une cloche mobile verticalement.
Sur la photo de gauche, la cloche est à son niveau maximum, alors que celle de
droite le volume de gaz stocké est bien moindre.
Pour assurer l'étanchéité la cloche repose sur une cuve contenant de l'eau et
c'est le volume de gaz qui fait lever la cloche.
 Une
entrée
de l'usine située rue de Dequevauvilliers (Chemin départemental n°9) était
encore visible fin des années 2010. C'était la partie carbochimie de
l'activité celle des dérivés du coke vus plus haut.
Une
entrée
de l'usine située rue de Dequevauvilliers (Chemin départemental n°9) était
encore visible fin des années 2010. C'était la partie carbochimie de
l'activité celle des dérivés du coke vus plus haut.
 L'usine
à gaz avenue d'Épinay sur la commune de Gennevilliers1.
On voit les maisons du personnel de l'usine.
L'usine
à gaz avenue d'Épinay sur la commune de Gennevilliers1.
On voit les maisons du personnel de l'usine.

 L'entrée
principale et son portail monumental, nettement plus majestueuse, se situait boulevard d'Épinay.
L'entrée
principale et son portail monumental, nettement plus majestueuse, se situait boulevard d'Épinay.
Sur le frontispice on peut lire "Société d'éclairage, de chauffage et
de force motrice".
Le portail en fer forgé est resté en place jusque dans les années 2010.
Espérons qu'il ait été sauvegardé.

 À
cette époque Villeneuve-la-Garenne n'était qu'un petit bourg agricole dont le centre
était situé boulevard Gallieni desservie du 1er janvier 1922 au 20
avril 1925 par la ligne de
tramway 78 Saint Denis-hôpital—Villeneuve-la-Garenne.
À
cette époque Villeneuve-la-Garenne n'était qu'un petit bourg agricole dont le centre
était situé boulevard Gallieni desservie du 1er janvier 1922 au 20
avril 1925 par la ligne de
tramway 78 Saint Denis-hôpital—Villeneuve-la-Garenne.
 L'usine
était reliée à la ligne du chemin de fer du Nord en gare de Gennevilliers
classée Monument Historique.
L'usine
était reliée à la ligne du chemin de fer du Nord en gare de Gennevilliers
classée Monument Historique.
 La
gare de Gennevilliers dans l'architecture Nord pur style dit de la
"meulière".
La
gare de Gennevilliers dans l'architecture Nord pur style dit de la
"meulière".
Construite par décret présidentiel de 1905, l'ancienne gare de Gennevilliers a été inaugurée le
1er juillet 1908. Elle appartient alors à la Compagnie des chemins de fer du Nord.
Un train en direction
de Paris.
Notes :
1
La Commune de Villeneuve-la-Garenne était avant 1929 un quartier de
Gennevilliers.
2
Le gaz de ville contient de l'hydrogène 53,3%, du méthane 23,5%, de l'oxyde de
carbone 7,7%, du gaz carbonique, 3,7%, de l'azote 11,4%, de
l'oxygène, de l'éthane C2H6 et du sulfure d'hydrogène H2S.
|
Page
precedente
 J'ai
retrouvé aux archives municipales de Gennevilliers ce plan ancien de
l'usine à gaz de Villeneuve-la-Garenne avec son réseau interne de voies
normales embranchées sur la ligne Paris-Nord—Pontoise en aval de la gare de
Gennevilliers.
J'ai
retrouvé aux archives municipales de Gennevilliers ce plan ancien de
l'usine à gaz de Villeneuve-la-Garenne avec son réseau interne de voies
normales embranchées sur la ligne Paris-Nord—Pontoise en aval de la gare de
Gennevilliers.