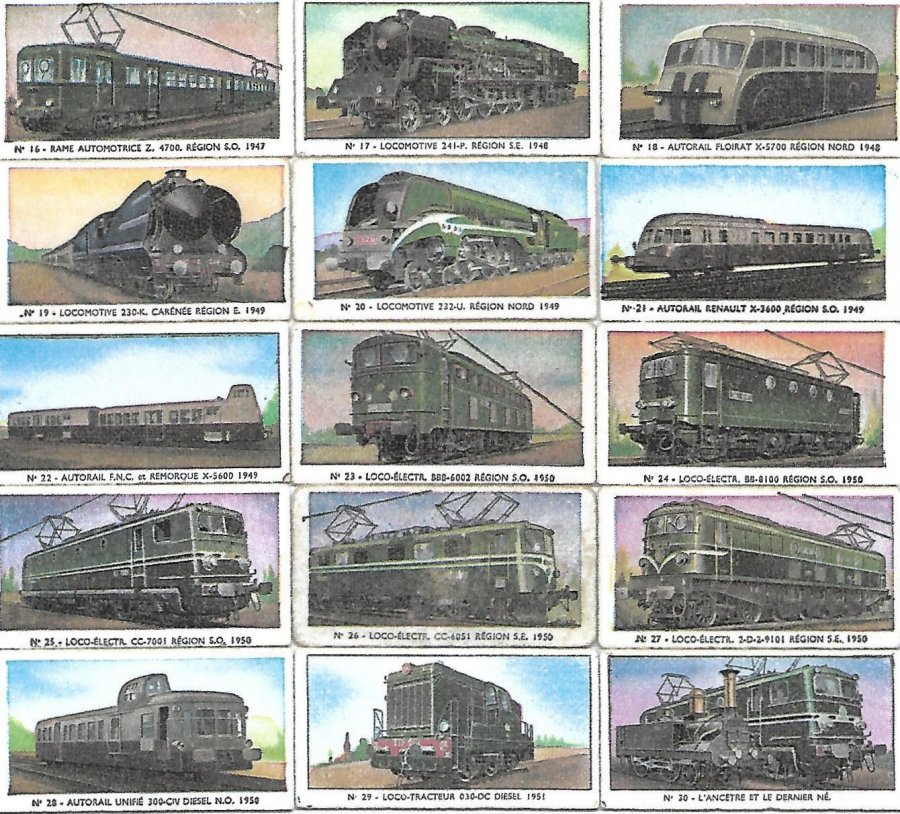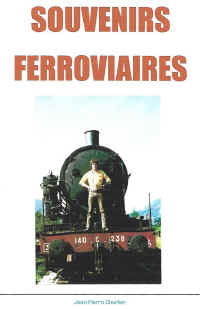 Souvenirs
ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956
Souvenirs
ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956Le carnet du CFC
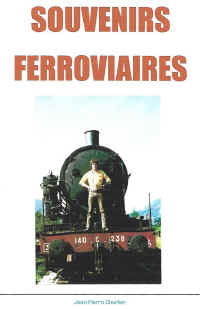 Souvenirs
ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956
Souvenirs
ferroviaires - Chapitre 4 - Années 1954-1956
Jean-Pierre Charlier
Après
trois années consécutives pendant lesquelles les vacances se déroulèrent en
Normandie, à partir de 1954, c’est à nouveau pour trois années
consécutives que nous nous rendrons en Anjou dans un village du nom de
Saint-Aubin-de-Luigné (49). Il se situe dans la vallée du Layon, petit
affluent de la Loire.
Nous quittions Paris toujours par la gare Montparnasse, mais par un autre
itinéraire, qui celui-là était électrifié dès le départ jusqu’au Mans.
A partir de cette ville, c’était à cette époque la traction vapeur qui
assurait le relais pour toutes autres directions.
Comme locomotives électriques, pour assurer les trains de voyageurs, il n’y
avait en ce temps là, sur cette ligne, que les 2D2 5400 (5401 à 5423). Grosses
machines d’un aspect austère, de couleur vert foncé avec toutefois quelques
filets rouges autour des hublots latéraux. Ce qui m’a toujours déplu sur ces
machines, c'est leur phare unique central qui leur donnait une apparence de
cyclope. À partir de 1962, la série passant en grande révision, elles
reçurent enfin des phares unifiés, un bandeau en aluminium avec au milieu le
classique sigle SNCF aux lettres entrelacées, que l’on retrouvait sur
beaucoup de véhicules ferroviaires. De plus, la couleur verte s’étant cette
fois éclaircie, elles retrouvèrent ainsi un aspect avenant.
Voilà venu le moment d’expliquer la dénomination des machines électriques
(on dit aussi la motrice, terme qui ne s’applique d’ailleurs qu’à ce type
d’engin). Les roues motrices sont ici désignées par une lettre. D, étant la
quatrième lettre de l’alphabet, signifie que cette machine est doté de
quatre essieux moteurs. Les chiffres 2 indiquent le nombre d’essieux porteurs.
Donc une 2D2 dispose de deux bogies de deux essieux porteurs encadrant quatre
roues motrices. Sur ces machines, les roues motrices sont de grand diamètre
(1,75 m), les porteuses (1 m). Sur une loco vapeur, cette disposition
correspondrait au type 242. Le type 2D2 a été abandonné au profit des types
BB et CC, ce qui veut dire que ces locomotives sont constituées de deux bogies
de deux essieux moteurs (BB), ou deux bogies de trois essieux moteurs (CC). Ce
sont les cas les plus fréquents. Autres exemples : BBB, 2CC2, 1CC1, 2BB2,
1ABBA1, les quatre derniers cas concernent des locomotives affectées à la
ligne dite de Maurienne, ligne de montagne aux fortes rampes, nécessitant des
engins puissants et de forte adhérence.
Revenons maintenant à notre voyage de 1954. A partir du Mans, changement de
mode de traction. C’est maintenant une machine à vapeur qui nous conduit
jusqu’en gare d’Angers. J’ignore hélas quelle était la machine, mais il
y a fort à parier que c’était encore une 141 P, les 241 P n’arrivant au
Mans qu'en 1958 en provenance du dépôt de la Chapelle, chassées par l’électrification
de Paris-Lille. Depuis Angers, pour atteindre Saint-Aubin, il nous fallait
prendre un car. Car Citroën, de couleurs marron foncé et brun clair. Une
grande galerie sur le toit, sur lequel on accédait par une échelle située à
côté du coffre, la porte de ce coffre restait souvent en position ouverte, car
elle servait de support pour les malles, colis ou autres caisses. Ces cars
assuraient aussi un service messagerie, et dans chaque village traversé, ils
déposaient leurs lots de voyageurs et de paquets divers. A Saint-Aubin il y
avait une gare SNCF, mais le service marchandises était interrompu depuis l’été
1951 (celui des voyageurs l’étant depuis 1938). Cependant en 1954 les rails
étaient encore en place. D’ailleurs nous empruntions occasionnellement la
voie ferrée aux cours de nos diverses randonnées. C’était la première fois
que je voyais des traverses métalliques. Je glanais parfois des vieux tire-fond
abandonnés sur le ballast avec la ferme intention de les ramener comme
souvenir, mais vu la charge accumulée, j’abandonnais bien vite ce projet…
En gare il y avait un aiguillage donnant accès à une voie desservant la cour
marchandise. Cette ligne joignait Chalonnes (sur la ligne Angers - Cholet) à
Perray-Jouannet puis au-delà, Montreuil-Belley (sur la ligne Saumur -
Bressuire).
En 1955 la voie était toujours en place. Un jour, nous étions partis rendre
visite à des amis qui avaient une ferme près d’un ancien passage à niveau.
Curieusement, alors qu’il n’y avait pas de gare à cet endroit, il y avait
cependant une voie de garage en impasse et de ce fait un aiguillage. Je n’ai
pas pu résister à l’envie de le manœuvrer. C’était un peu dure, mais je
voyais bien les lames d’aiguille se déplacer à chacune de mes impulsions sur
le levier. Quelques instants plus tard, alors que je jouais avec les enfants de
la ferme, j’ai sûrement connu la plus grande frayeur de ma vie. J’étais
perché en haut d’une échelle donnant accès à une grange, lorsque j’entendis
comme un klaxon d’autorail, et à ma grande surprise je vis apparaître une
petite draisine se dirigeant en direction de Chalonnes. Aussitôt me reviennent
à l’esprit mes manipulations de l’aiguillage. L’avais-je bien remis dans
la bonne position ? N’allais-je pas être responsable d’un déraillement ?
Heureusement, à mon grand soulagement la draisine a continué sa route sans
encombre. Le hasard avait-il fait que l’aiguille était remise dans sa
position initiale, ou bien était-ce un aiguillage talonnable ? De toute façon
d’après le souvenir qu’il m’en reste, la draisine se dirigeant vers
Chalonnes, abordait donc cette aiguille en talon, c’est-à-dire que dans ce
sens de franchissement les lames d’aiguille sont automatiquement repoussées
par les roues du véhicule franchissant l’appareil (à moins que celui-ci ne
soit verrouillé). Il y a deux manières d’aborder une aiguille : en pointe,
le véhicule est alors dirigé soit sur voie principale, soit sur voie déviée
; ou bien en talon, le véhicule venant de l’une ou l’autre des deux voies
et continuant sur voie principale.
Il faut avouer que c’est une coïncidence incroyable. Alors que depuis des
années il n’était sans doute passé aucun engin ferroviaire sur cette ligne
abandonnée, il a fallu que cela arrive juste le jour ou un gamin fasse joujou
avec un aiguillage !…
En 1956,
la voie était déposée. D’ailleurs, le passage de la draisine l’année
précédente était sûrement en rapport avec la future dépose de la voie. Sans
doute une tournée d’inspection pour étudier le futur chantier.
Ce retour de vacances de Saint-Aubin en 1956 marque un tournant dans mes
connaissances ferroviaires. Je me souviens très bien de l’arrivée en gare d’Angers
de notre train, tiré avec certitude par une magnifique 141 P jusqu’en gare du
Mans. Au cours de ce voyage je notais sur un papier tous les numéros que je m’efforçais
d’apercevoir sur tous engins auprès desquels nous passions. Hélas, je n’ai
plus aujourd’hui ce précieux papier, mais je me souviens y avoir noté à l’approche
de Paris, des numéros de locomotives électriques ne comportant que trois
chiffres, sans doute des BB 800 et 900, et plus curieusement aussi des numéros
à deux chiffres, sans doute BB 1 à 80. Mais logiquement, elles n’auraient
pas dû se trouver là, car affectées à la région Sud-Ouest. Cependant il n’est
pas impossible qu’un engin de cette région vienne dans le secteur de
Montparnasse par le biais de la grande-ceinture. Sur les points frontières
entre deux régions SNCF, on pouvait effectivement voir se côtoyer des locos de
régions différentes.
Exemple, à Dijon des locos du Sud-Est et de l'Est, à Lille des locos du Nord
et de l'Est, etc.
Il faut que je précise ici, que depuis 1955, j’avais été initié par un beau-frère aux secrets du marquage des locomotives, et avec l’expérience je commençais à reconnaître au premier coup d’œil les engins les plus fréquemment rencontrés, notamment les 141 R omniprésentes. C’est aussi cette année là que j’ai fais la découverte de ces fameux petits cartons que distribuaient les balances de gare. Je me souviens que pour une pièce de 20 centimes glissée dans cette balance on obtenait un ticket sur lequel figurait, bien sûr le poids et la date, mais de l’autre côté, ô merveille, une image de train. C’était pour moi un trésor inestimable, et cette fois par contre, je détiens encore la collection complète, à savoir, les trente tickets qui la constituaient. Le samedi après-midi, en sortant de l’école, je passais par la gare d’Enghien, et parfois je retrouvais des tickets traînant par terre, abandonnés pour mon plus grand bonheur « par des inconscients » . Je conseillais aussi les membres de la famille de m’approvisionner quand l’occasion se présentait. Au fil du temps j’ai donc réussi à constituer cette collection. J’ai ainsi enrichi mes connaissances ferroviaires. Il y avait des locomotives à vapeur, diesel, électrique, mais aussi des autorails et des automotrices. Certains tickets sortaient plus fréquemment que d’autres. C’était le cas de la 230 K carénée de l’Est (j’aurai l’occasion de reparler de cette 230 K qui m’a causé « bien du tracas »).
... ce qui m'a toujours déplu sur ces machines, c
'est leur phare unique central qui leur donnait une apparence de cyclope. À partir de 1962, la série passant en grande révision, elles reçurent enfin des phares unifiés, un bandeau en aluminium avec au milieu le classique sigle SNCF... Photo
Maurice Mertens
Photo
Maurice Mertens...À partir du
Mans, changement de mode de traction. Il y a fort à parier que c'était une 141
P...
 Phot
Guy Rannou
Phot
Guy Rannou
141 P sur un express,
vers Argentan, en septembre 1966
Voici la collection de tickets de balances de gares. Sur cette première image, on peut y voir le verso sur lequel apparaît la date et le poids de la personne, puis les quinze premiers cartons. Il y quatre engins cité dans le texte :
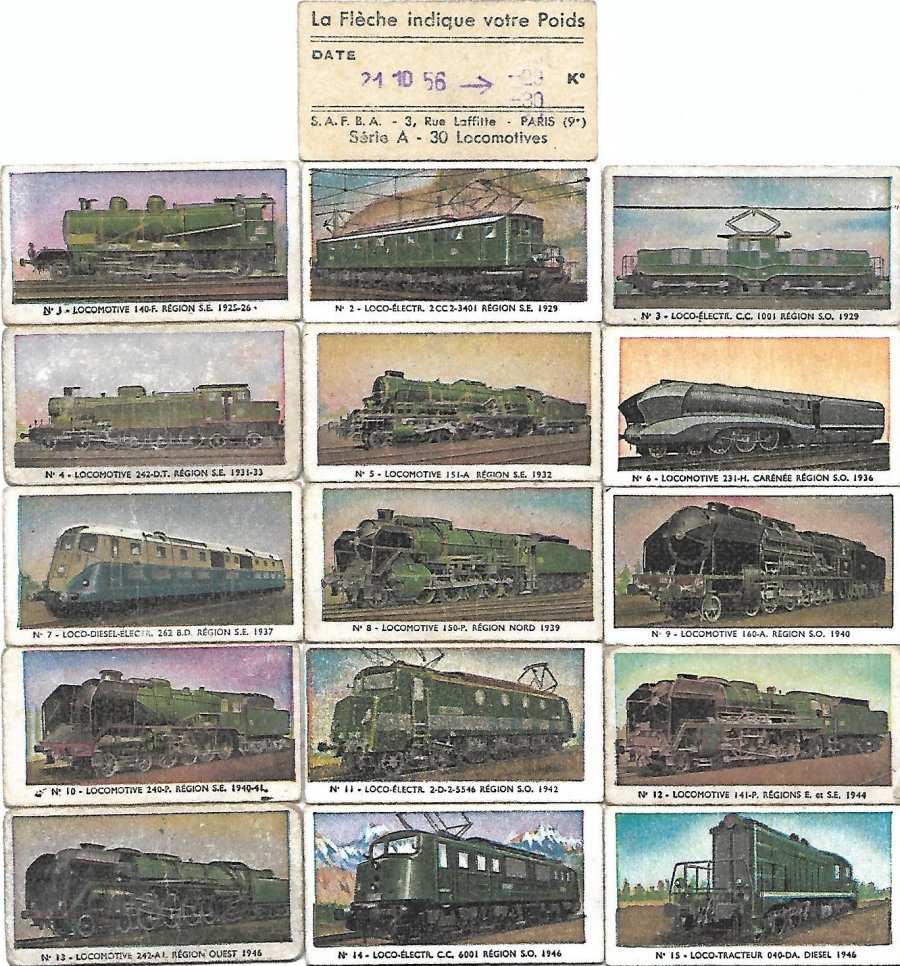
Et voici les quinze derniers tickets de cette précieuse collection. Sont mentionnés les engins suivants :